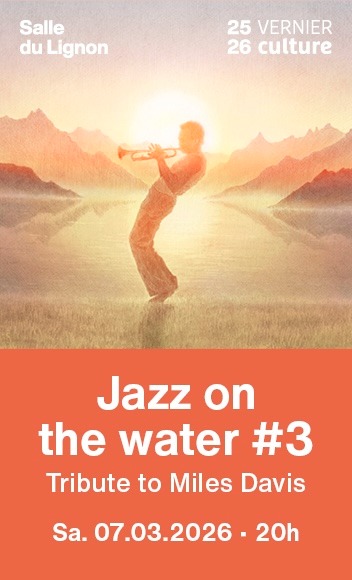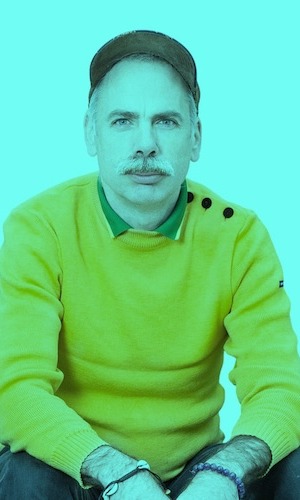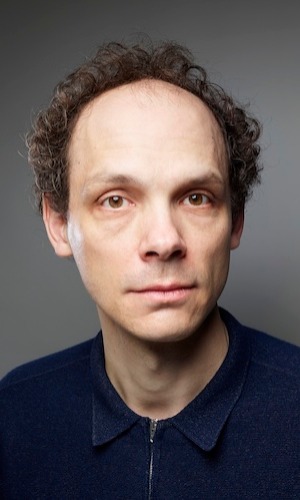Ubu ou la guerre intérieure
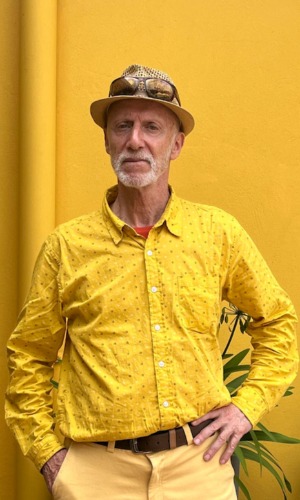
Ubu roi n’est pas seulement une farce scatologique héritée d’Alfred Jarry. C’est un miroir tendu à notre époque, une plongée dans les mécanismes du pouvoir, de la peur et du désir.
Gabriel Alvarez, en inscrivant la pièce dans le cadre plus vaste de l’Ubu Wars Project, en fait un laboratoire où la guerre n’est plus un sujet, mais un état du monde. On y voit des corps exposés, des vies précaires, des appétits dévorants.
Et au centre, Ubu, roi de nulle part, père sans descendance. Il incarne avec une lucidité cruelle notre propre pulsion de consommation et de domination.
Les acteurs et actrices – Karim Abdelaziz, Clara Brancorsini, Lou Golaz, Soufiane Guerraoui, Margot Le Coultre, Madeleine Piguet Raykov, Justine Ruchat – ne jouent pas Ubu; ils·elles l’incarnent, le mangent, le crachent.
La scène devient alors un espace viscéral, à la fois digestif et mental, où le haut et le bas s’affrontent, où la lumière côtoie l’ombre. Alvarez y déploie une polyphonie de corps et de voix, mêlant chœurs, rythmes et chants.
Le langage de Jarry, tissé de «merdre» et de néologismes, devient une matière sonore, presque charnelle. Une question se dissimule derrière chaque mot, chaque geste: qu'est-ce que le pouvoir, sinon cette capacité à détruire et à créer, à dévorer et à régner?
Rencontre avec Gabriel Alvarez.
Vous montez Ubu roi d’Alfred Jarry au cœur d’un projet plus vaste, Ubu Wars Project.
Gabriel Alvarez: Plus qu’une simple réflexion sur la guerre, c’est une interrogation sur la vie elle-même. Qu’est-ce que la vie? Comment en prend-on soin? Et qui, surtout, déterminerait quand une vie doit finir? C’est là une problématique centrale de la guerre.
Cette réflexion sur la vie amène inévitablement à nous interroger sur le pouvoir: comment se manifeste-t-il aujourd’hui? De quelles manières est-il diffus dans notre société?
De surcroit, il y a la question du désir. Car Ubu roi, comme Judith ou le corps séparé de Howard Barker, pièce qui sera montée à l’avenir, compose une sorte de diptyque. Ces pièces touchent aux problèmes de l’ambition et des appétits dévorants des personnages.
Quels sont les éléments qui vous ont attiré dans cette pièce de Barker?
Howard Barker part de l’histoire biblique de cette femme qui doit sacrifier son désir – elle tombe amoureuse d’Holopherne – pour lui trancher la tête. Holopherne, ce maréchal, ce général, est habité par la guerre.
Il y a donc toute une réflexion philosophique sur ce que peut signifier l’acte de tuer et celui de faire la guerre. La pièce se déploie en un huis clos étouffant entre ces trois personnages, un terrain miné où le désir et la mort se confondent.
Revenons à Ubu roi. Qu’est-ce qui, au-delà de son actualité, vous a séduit dans l’écriture de Jarry, si intimement liée à sa biographie et à l’enfance?
C’est une pièce extraordinaire, d’une jeunesse folle malgré ses presque 130 ans. Elle reste d’une insolente actualité, frappante. Son écriture ne passe pas, ne vieillit pas.
C’est le génie de Jarry, d'avoir créé une pièce qui procure une joie pure, immédiate, à la lire et à l’entendre. C’est une fête verbale et une descente aux enfers.
Il y a dans le Père Ubu une dimension scatologique, organique avec son «merdre». Comment abordez-vous ce corps grotesque et dévorant?
L’homme de théâtre anglais Peter Brook disait que le théâtre est le lieu où la merde et l’or se mélangent. Je crois que c’est très présent chez Jarry. C’est ce rapport au ventre, à cette usine qui produit et qui élimine.
Ubu est une abstraction. Dans ce ventre vide de vie, on peut tout mettre, et il détruit, mais en même temps, il crée énormément de choses.
On peut parler d’un stéréotype, d’une caricature de dictateur impitoyable. Mais il y a aussi quelque chose d’archétypal en nous, ce rapport que nous avons à notre ventre. Qu’est-ce qu’on produit? Qu’élimine-t-on?
Votre scénographie semble reprendre cette idée que Jarry réduit souvent Ubu au fonctionnement d’un tube digestif.
Absolument. La gidouille, la nourriture, la défécation reviennent sans cesse. Si on est ce que l’on mange, on est aussi ce que l’on défèque.
C’est toute la dimension philosophique du personnage. Le philosophe allemand Emmanuel Kant lui-même a écrit un petit texte sur la constipation et la défécation! Cela montre l’importance du sujet.
La scénographie s’inspire de cela: deux étages. Un étage inférieur, caché, très organique, et un étage supérieur, lumineux. Le public va découvrir cet espace, cette aspiration, cette espèce de caniveau, de cave, et ce côté plus extérieur.
C’est parti de cette «gidouille» dont parle Jarry, le ventre et les entrailles, les tubes digestifs.
Le travail sur la parole, la polyphonie, est au cœur de votre parcours. Comment ce souci de la choralité se manifeste-t-il pour cette création?
J’ai réalisé une adaptation du texte. Dans la pièce originale de Jarry, qui est une parodie du Macbeth shakespearien, on a le couple Père Ubu/Mère Ubu. J’ai choisi d’intégrer les trois sorcières imaginées par Shakespeare pour son Macbeth, remplaçant un peu les «Palotins»* de Jarry.
Nous avons ainsi les trois sorcières et deux autres personnages qui créent un chœur, un rapport permanent, via le langage ou les chants, avec le Père et la Mère Ubu.
C’est un clin d’œil à la tragédie grecque, au lien entre le chœur et le héros – sachant qu’ici, Ubu est plutôt un anti-héros.
Comment voyez-vous le personnage d’Ubu?
C’est grotesque, caricatural, mais Alfred Jarry est extraordinaire: Ubu est roi de nulle part. Voici un roi qui ne veut pas l’être, c’est la Mère Ubu qui l’y oblige. Il y a une impuissance dans le personnage, à tous les niveaux, et c’est de là que naît le despote.
Bien sûr, on peut penser à Trump, à Poutine et à tant d’autres. Mais pour moi, Ubu est un prophète, un philosophe de notre époque moderne, de notre égolâtrie.
Nous sommes dans une époque complètement égolâtre. Nous pouvons tous, d’une certaine manière, nous identifier à Ubu. Cette frénésie à satisfaire nos appétits, nos désirs, la consommation... Ubu ne pense qu’à manger, à consommer. Il est le reflet grotesque de cette pulsion.
Dans la pièce, l’armée d’Ubu se prépare à affronter les Russes en Ukraine. La bataille tourne à la débandade à cause de la lâcheté d’Ubu, et il se réfugie dans une caverne où lui apparaît la Mère Ubu. Comment abordez-vous cet épisode?
Ma lecture de cette scène, au-delà du contexte de la guerre, porte sur le phénomène de la culpabilité. L’auteur, volontairement ou non, met en question toutes les valeurs de l’Occident chrétien, et notamment la culpabilité.
Il inverse ces valeurs. Ubu n’a aucune culpabilité, aucun remords; il tue pour satisfaire ses désirs.
Dans cette scène de l’apparition, la Mère Ubu feint d’être l’ange Gabriel, annonciateur. C’est une parodie, un clin d’œil très ironique à ces valeurs de la chrétienté.
Le grotesque chez Jarry passe aussi par une rythmique: le bégaiement, le chant, la répétition.
Nous avons beaucoup travaillé sur la répétition. Pas seulement la répétition de la langue, mais aussi la répétition des mouvements. Au plan dramaturgique, nous avons fait un travail important sur le rythme.
J’ai ensuite proposé au compositeur Sylvain Fournier de mettre en musique certains passages; les trios de sorcières chantent beaucoup. Il y a aussi des chants du chœur, notamment pendant les scènes de guerre, où nous avons créé des scènes rythmiques pour établir certaines atmosphères, certains climats.
Un des points forts de la pièce est cette violence qui vient de nous-mêmes, cette pulsion vers le pouvoir absolu.
Dans mon travail avec les acteurs et les actrices, je passe beaucoup par ces interprètes. Je pose des questions sur leurs rêves, leurs souvenirs. Je les interroge: qu’est-ce que ces personnages de la pièce peuvent représenter pour nous? Qu’est-ce que nous avons d’eux en nous?
La problématique de la violence et de la cruauté comment peut-on la trouver dans un comportement complètement enfantin? L'homme de théâtre, écrivain, essayiste, dessinateur et poète français, Antonin Artaud, parlait de théâtre de la cruauté, mais Alfred Jarry, avec Ubu, était en avance.
Nous avons donc réalisé beaucoup d’improvisations sur les colères de notre enfance. Ce rapport à l’enfance dont Ubu n’a pas pu sortir; il n’est même pas un adolescent. Plutôt un enfant dépendant, qu’il faut nourrir, avec ses caprices, ses colères et… sa crotte.
Propos recueillis par Bertrand Tappolet
Ubu roi
Du 18 au 30 novembre 2025 au Théâtre du Galpon
Gabriel Alvarez, direction artistique - Studio d'action théâtrale
Avec Karim Abdelaziz (Père Ubu), Clara Brancorsini (Mère Ubu), Justine Ruchat, Lou Golaz, Soufiane Guerraoui, Madeleine Piguet Raykov, Soufiane Guerraoui Justine Ruchat et Margot Le Coultre
Informations, réservations:
https://galpon.ch/spectacle/ubu-roi/
*Dans Ubu roi d’Alfred Jarry (1896), les Palotins sont les soldats grotesques et serviles du Père Ubu, formant sa garde et son entourage immédiat. Ce sont des personnages caricaturaux, obéissants jusqu’à l’absurde, qui participent à ses crimes et le flattent sans réfléchir.
Leur nom, inventé par Jarry à partir du mot «paladin», tourne en dérision l’héroïsme chevaleresque: les Palotins représentent la bêtise, la soumission et la corruption du pouvoir, ndr.